Depuis la première conférence sur le climat (COP) lancée en 1979 à Genève, les prises de conscience que la planète n’est pas une ressource infinie ont progressivement conquis les mentalités. Ainsi, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), née en 1988 de la volonté de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), procède à intervalles réguliers à une évaluation des connaissances sur le changement climatiques. Deux ans après, les conclusions de la première étude mettent clairement en évidence la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique.
Le troisième sommet de la Terre, en 1992 à Rio de Janeiro, est conclu par la signature de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
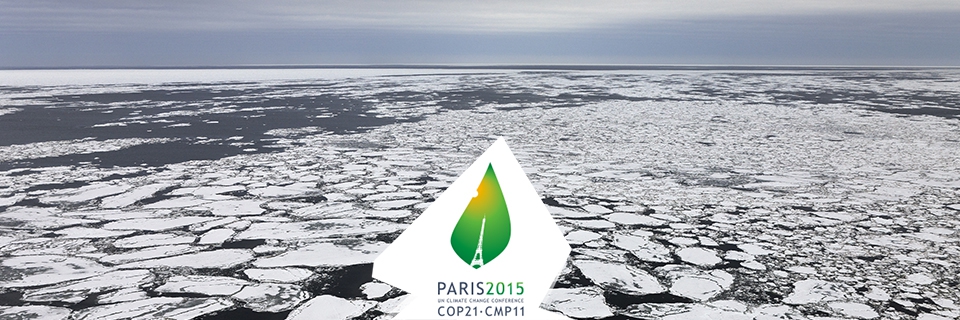 la COP21 a Paris en 2015
la COP21 a Paris en 2015Lors de la COP21 à Paris en 2015, 195 pays sont finalement réunis. Les chefs de gouvernements se mettent en définitive d’accord pour limiter le réchauffement mondial à 1,5°C/ 2°C d’ici 2100.
L’Union Européenne s’engage à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de 1990 d’ici 2030, de 80 à 95% d’ici 2050.
En France, la loi de Transition énergétique pour la croissance verte votée en Août 2015 anticipe cet accord. Les décrets d’application qui suivent la loi précisent les objectifs en tenant compte de l’Accord de Paris.
Il semblerait que les dernières élections au Parlement Européen du 26 mai 2019 aient marqué la profonde évolution des votes des peuples européens plaçant les partis politiques écologistes en seconde ou troisième place, comme ce fut le cas en Allemagne ou en France.
La révolution numérique impacte enfin le bâtiment comme elle a déjà révolutionné l’industrie.
Olivier CELNIK, architecte BIM, Directeur du Mastère Spécialisé BIM de l’Ecole des Ponts ParisTech est pleinement conscient de cette révolution, lui qui, dès les années 90 travaillait déjà ses plans sur un logiciel informatique. Désormais le BIM fait une percée dans le monde de l’architecture. Plus un seul projet d’envergure mené par les majors de l’industrie n’est fait sans faire appel au BIM en conception.
Par exemple, Bouygues Construction Ile de France a utilisé le BIM pour la première fois lors de la conception et sur toute la phase de suivi de chantier de l’agrandissement de l’hippodrome de Longchamps.
“C’est un magnifique outils qui fait gagner du temps à toutes les étapes de la conception en évitant les incohérences de plan. Lors des travaux le BIM nous permet de suivre l’avancée des travaux étape par étape avec une précision que nous n’avons jamais eu auparavant”
Frédéric GAL
disait Frédéric GAL, responsable études de prix, Bouygues Ouvrages Publics, lors de la visite du chantier en juillet 2017. L’étude des données de l’observatoire E+C- du ministère de la transition écologique fait ressortir une évolution notable du taux de prise en compte du BIM dans les projets présentés. A fin juillet, 25% des projets avaient une maquette numérique. A fin août, c’est 27% des projets qui l’utilisent.
Télétravail – coworking
Selon une étude du cabinet JLL “future is flexible”[1]la réussite des espaces de bureaux flexibles aux États-Unis et en Grande-Bretagne laisse augurer en réalité de belles perspectives d’avenir pour ces lieux en France.
Ainsi depuis l’ouverture du premier espace de coworking à San Francisco, plus de 4 000 surfaces de ce type, représentant déjà près de 4,8 millions de m2, ont vu le jour aux États-Unis, pour une part de marché mondiale d’environ 30%. Si les principaux marchés américains — Californie, New York, Floride et Texas — sont aujourd’hui bien pourvus, les perspectives d’évolution de ce type d’espaces sont toujours orientées à la hausse, portées par un contingent important de travailleurs indépendants mais aussi par la demande des grandes entreprises.
Les bureaux flexibles n’en sont pourtant qu’à leurs prémices en France, avec un nombre encore limité de centres, comparativement au parc tertiaires classiques (estimé à 0,6% du parc pour les centres hybrides et à 1,1% avec les centres d’affaires). La réussite de ces espaces dans les pays anglo-saxons et dans d’autres pays européens, laisse penser que le gisement potentiel de développement est encore important en France.
Sur les 1009 actifs interrogés dans le cadre de l’enquête JLL-CSA “« Travail liquide, augmenté, disrupté, pour quel futur les Français sont-ils prêts ? », 42 % sont séduits par l’idée qu’en 2030 les travailleurs seront tous nomades et que ce sera la fin du bureau comme lieu de travail principal.
Transports – Plans de déplacements entreprises (PDE)
L’article 51 applicable au 1er janvier 2018 de la loi sur la transition énergétique exige que « dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité. »
Cette mesure, qui vise à cet égard, à améliorer la mobilité de ses employés, s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Chacune des entreprises concernées a pour objectif de définir une stratégie durable afin de favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle et ainsi réduire la pollution tout en changeant les comportements de ses collaborateurs. Le PDE s’applique à tous les déplacements liés à la vie professionnelle : les trajets domicile-travail, les rendez-vous à l’extérieur ou encore les déplacements des employés en France comme à l’étranger.
Friches industrielles – foncier transitoire
La part de l’industrie dans le PIB français a été divisée par deux en 45 ans[2], avec pour principale conséquence la création d’un grand nombre de friches industrielles.
L’institut de l’aménagement et de l’urbanisme ile de France (IAURIF) notait en 1999 un doublement en 5 ans du nombre de sites laissés à l’abandon. Dix ans plus tard[3], le phénomène s’est nettement réduit du fait de la pression du marché et la transformation en logement, mais il a également changé de nature. Délocalisation d’activité mais surtout obsolescence rapide de bâtiment (du fait des contraintes en matière d’hygiène et de sécurité) et désormais exigence de performance énergétique ont générés de nombreuses friches. Autre nouveauté ces dernières années, les friches logistiques, presque inexistante dans les premières études de l’IAURIF sont nombreuses aujourd’hui en raison de l’évolution des pratiques et techniques de gestion des flux et des normes relatives aux entrepôts.
En région, c’est la désertification qui pousse à transformer d’ancien commerces en friches. C’est le cas notamment d’Immo-Mousquetaire, la foncière d’Intermarché, très présent dans les zones rurales hors de la région parisienne, qui se retrouve obligée de fermer des supermarchés (3000 m2) pour les rouvrir quelques kilomètres plus loin, là où la population s’est déplacée.
sj
[1]http://www.jll.fr/france/fr-fr/etudes/etude-investisseurs-coworking-nouveaux-bureaux-flexibles
[2]https://www.lopinion.fr/edition/economie/part-l-industrie-dans-l-economie-francaise-a-ete-divisee-deux-en-45-101707
[3]https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_574/467web_01.pdf